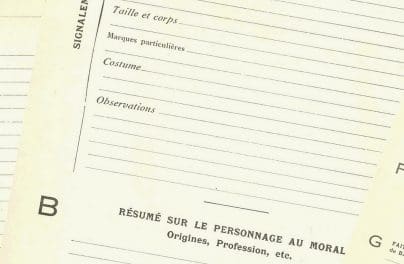Ce Mistigris n’est pas le seul personnage animal de La Comédie humaine. Outre les très nombreuses métaphores animales qui parsèment l'ensemble de l'oeuvre (M. de Mortsauf dans Le Lys a "un visage de loup blanc" et ressemble "à une bête affamée sortant d'un bois"), il y a bien sûr tous ceux qui ne sont pas nommés, et qui font pour ainsi dire figuration : le singe de la comtesse Ferraud dans Le Colonel Chabert par exemple. Il y a aussi ces personnages, ô combien importants, qu’on appelait « lions », c’est-à-dire les dandies comme La Palférine, Maxime de Trailles et bien d’autres, ces élégants qui se pavanent, les rois de la bonne société. Ces lions ont à leur service des garçons qu’on appelle des « tigres ‒ et c’est ainsi que tigres, et surtout lions, parcourent de leur démarche hautaine l’ensemble de La Comédie humaine. Mais Mistigris est un vrai animal, il est identifié, il a un rôle, et un nom. D’autres sont comme lui, parmi lesquels la jument Pénélope dans La Vieille Fille, qui appartient à la vieille fille du titre, Rose Cormont, par ailleurs assaillie de prétendants ‒ et on peut de ce fait se demander qui sera son Ulysse. Ou les chevaux Abd-el-Kader et Sultan, appartenant respectivement à Calyste du Guénic dans Béatrix et au « lion » Henri de Marsay dans La Fille aux yeux d’or. Un crapaud, Astaroth, et une poule, Cléopâtre, chez la cartomancienne madame Fontaine dans Les Comédiens sans le savoir et Le Cousin Pons. Il y a aussi Couraut, le chien fidèle de Michu, presque son alter ego, dans Une ténébreuse affaire ‒ mais surtout, surtout : il y a l’inoubliable et superbe panthère Mignonne dans Une passion dans le désert, qui seule fait l’objet d’une nouvelle entière, et seule se trouve vraiment personnifiée : féminine, douce, majestueuse, coquette, séductrice, troublante, elle n’est pas sans rappeler la Paquita de La Fille aux yeux d’or. « Mais il y avait tant de grâce et de jeunesse dans ses contours ! C’était joli comme une femme. La blonde fourrure de la robe se mariait par des teintes fines aux tons du blanc mat qui distinguait les cuisses. »
Ceci ne concerne que La Comédie humaine, mais Balzac écrivit aussi, entre 1841 et 1842, quatre histoires animalières dans un recueil intitulé Scènes de la vie privée et publique des animaux, ensemble magnifiquement illustré par Granville et auquel participèrent notamment Nodier, Musset et George Sand. Parmi ces histoires, dans lesquelles les animaux sont en réalité des humains animalisés, se trouve les fameuses « Peines de cœur d’une chatte anglaise » ‒ il y en même une cinquième, qu’il écrivit lui-même mais qui fut signée George Sand : « Voyage d’un moineau de Paris à la recherche d’un meilleur gouvernement ». Chez Balzac, en vérité, les animaux sont partout.
Tout près du château de Saché, derrière le « Vallon tranquille et solitaire » du Lys, se trouve un lieu que l’on désigne du nom de « Ravin inculte ». C’est un val assez sombre et plutôt inhospitalier, avec une grotte (disons une anfractuosité), dans laquelle, aux alentours de 1630, se rencognait Marguerite de Rousselé, fille du seigneur de Saché, une jeune mystique que l’on surnommait dilecta, « la bien-aimée ». C’est ainsi que Balzac surnommera Laure de Berny, le modèle d’Henriette de Mortsauf pour Le lys dans la vallée. Marguerite restait là, dans le murmure du ruisseau et le bruissement des arbres, dans l’humidité, dans l’ombre et la fraîcheur du ravin, et sans doute aussi dans la lumière et la chaleur de ce Christ qu’elle aimait. Des chevreuils, des renards, des lapins, des sangliers peut-être, la visitaient, ou la regardaient de loin. Ils sont toujours là : j’ai vu leurs traces dans les bois, et aussi dans le « vallon solitaire ». Il ne lui fallait que dix minutes pour regagner, à pied, le château où deux siècles plus tard Balzac écrirait deux de ses chefs d’œuvre, un château similaire à celui où dans une autre réalité Félix de Vandenesse jouerait au trictrac avec M. de Mortsauf, tandis qu’Henriette broderait à côté, le moins loin possible de Félix, un château où deux siècles plus tard encore, je parcourrais la salle de trictrac reconstituée, la chambre de Balzac, tous ces lieux dans lesquels il vécut, en y cherchant une trace évanouie, une persistance imaginée, une ombre, un signe. Le temps est un fil d’argent qui vibre dans la nuit. Nous sommes les araignées patientes qui, parfois, imaginons en percevoir l’écho.
Ou alors, à la manière de Corneille : « le temps est un grand maître ». Ou encore : « le temps est un grand maigre », faux proverbe cité par le peintre amateur de calembours Léon de Lora dans Un début dans la vie, puis repris par Pierre Michon comme titre de son texte sur Balzac dans Trois auteurs ‒ si bien que ce faux proverbe a fini par devenir plus connu que son original cornélien. Or il se trouve que ce jeune Léon de Lora a un surnom, sous lequel il est le plus souvent désigné, et que ce surnom est le nom du chat de Mme Vauquer dans Le Père Goriot : Mistigris, encore lui ‒ ce chat qui se frotte aux jambes de sa maîtresse comme tous les chats, qui lape une assiette de lait en manquant de la renverser comme tous les chats, et qui comme tous les chats disparaît un jour sans qu’on le retrouve jamais.
II s’agit donc d’un doublon. Il y en a un autre : le faux proverbe en question, « le temps est un grand maigre », est cité ailleurs, par un autre personnage : par Lousteau, dans Illusions perdues, roman que Balzac écrivit aussi à Saché. Mais Lousteau ne se l’approprie pas : il l’attribue à une certaine « Minette », une comédienne, ou une courtisane, comme il y en a tant chez Balzac, et qui peut-être, allez savoir, ne faisait que répéter ce qu’elle avait entendu de la bouche d’un client nommé Léon de Lora, alias Mistigris. « Minette », « Mistigris » : deux noms de chats donnés à des humains qui chacun mentionnent un même proverbe arrangé à leur sauce de calembour. La chose est singulière. Peut-être y avait-il réellement un chat nommé Mistigris au château de Saché lorsque Balzac y séjournait, ce qui lui donna l’idée de lui faire rejoindre la fiction du Père Goriot, puis d’en donner le nom à un personnage humain quelques années plus tard. C’est d’ailleurs la seule occurrence, dans toute La Comédie humaine, d’un même nom porté par deux personnages distincts, fussent-ils d’espèces différentes. On peut même trouver un troisième Mistigris (ce n’est donc plus un doublon, mais un triplon). Il ne s’agit là ni d’un humain, ni d’un animal, mais d’un jeu : un jeu de cartes que l’on désigne aussi, dans certaines régions, du nom de « mouche », et dont les règles sont minutieusement décrites dans Béatrix. Enfant, j’y jouais. Mistigris est le nom que l’on donne à la carte maitresse (« une carte terrible », écrit Balzac) : le valet de trèfle.
Nous voici donc avec trois Mistigris : un chat, un peintre et un jeu de cartes. Trois Mistigris, deux grands maîtres maigres, une flopée de personnages reparaissant, des labyrinthes de situations nécessitant dictionnaires et notes biographiques, des personnages animalisés, des animaux personnifiés, et d’autres qui, demeurés fidèles à leur nature animale, parcourent l’œuvre de bout en bout. J’ai beaucoup pensé à eux, pendant mon séjour à Saché. J’ai pensé à Mistigris, à Pénélope, à Mignonne et aux autres, y compris à ceux que Granville a dessinés, à tous ces animaux de papier auxquels venaient répondre leurs confrères de chair, d’os, de fourrure ou de plumes que je voyais, croisais, apercevais de loin, ou dont je percevais les traces ‒ bauge de sanglier, passage d’un renard, d'un blaireau, branches brisées d’un chevreuil dans un vallon ombré, des oies qui cacardaient me voyant arriver, un nid de mésanges, un concert de rouges-gorges, un chat. Je pensais à eux comme je pensais, forcément, à Félix de Vandenesse et à Henriette de Mortsauf, à Rastignac et à Goriot, à Balzac et à Mme Hanska, à Margonne et à Laure de Berny, aux lions, aux tigres, aux souris et aux hommes. Comédie humaine, comédie animale, fiction, réalité, tout cela m’accompagnait jusqu’au soir, où je me couchais confiant dans le grand silence noir, sachant que le lendemain me réveilleraient les merles.
Christian Garcin
=> Télécharger l'édition du texte par CICLIC (PDF, 2,7 Mo)